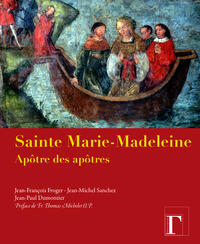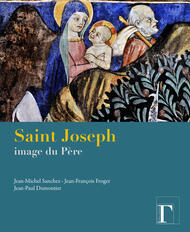Jean-Michel Sanchez
Docteur en histoire de l'art de l'Université d'Aix-Marseille I, spécialiste d'art sacré, Jean-Michel Sanchez est chargé de cours à l'Université de Provence, membre du Centre International d'Études sur le Linceul de Turin (Paris). Ses recherches l'ont conduit à s'intéresser à l'architecture et à la décoration des églises françaises, italiennes et espagnoles mais aussi à l'ensemble de leur contenu : chasublerie, orfèvrerie, art campanaire, orgues, mobilier liturgique... Sa connaissance et sa vision large et pertinente de l'ensemble de l'art chrétien du XVIIe au XIXe siècle en font l'un des meilleurs spécialistes actuels de l'art au service de la foi.


Eecho
Saint Joseph, Image du père, Éditions grégoriennes, 2015
Jean-François Froger, Jean-Michel Sanchez
(Photographies : Jean-Paul Dumontier)
Recension : Marion Duvauchel
Deux années avant la publication de l'ouvrage sur Marie-Madeleine, l'apôtre des Apôtres, les éditions Grégoriennes avaient fait paraître, par les mêmes auteurs et sur le même patron, un livre consacré à une autre figure suréminente : saint Joseph. Le sous-titre, « Image du Père », imprimé en creux sur la page de couverture, est un signal qui renvoie, selon toute vraisemblance, à l'ombre lumineuse dans laquelle la figure de Joseph s'est vue tenue pendant la longue histoire cultuelle de l'Église. Voilà donc un beau livre à la fois dense et élégant qui devrait contribuer à corriger la représentation bien erronée de l'aimable santon sulpicien figurant une paternité un peu débonnaire drapée dans une exemplaire discrétion.
L'ouvrage se déploie en deux chapitres d'une exceptionnelle densité et concision, suivis d'une sorte de petite Ennéade : neuf textes brefs en forme d'inventaire structuré (une petite « somme ») de l'essentiel de ce que l'on connait de saint Joseph : à travers les évangiles apocryphes ; à travers la doctrine théologique sur sa personne ; ce qui le préfigure dans l'Ancien Testament ; à la lumière de son culte, de ses lieux de dévotion, de ses apparitions, plus rares que celles de la Vierge Marie. Autant de petits chapitres où se voit rassemblée une information qui permet au lecteur de mieux se représenter le poids progressif que saint Joseph a pris dans la prière de l'Église et dans son histoire cultuelle ; ce qu'il doit aux grands saints ou au Carmel dans le passage du culte privé au culte public comme l'importance exceptionnelle que l'Espagne lui a accordée. Après avoir pénétré largement la vie dévotionnelle, saint Joseph entre dans les méditations des théologiens, dans leurs discussions aux subtilités parfois rabbiniques mais aussi dans l'art. C'est dans ce domaine que Jean-Michel Sanchez excelle : une iconographie commentée d'une grande beauté… Les passionnés de l'histoire de la piété trouveront par ailleurs les prières, offices et invocations, fort belles et aussi précieuses pour la prière personnelle ou collective que pour la culture religieuse, comme ils apprécieront le passage approprié de la lettre encyclique Quamquam pluries de Léon XIII.
En 1889, c'est fait, l'Église est placée nommément et formellement sous le patronage de saint Joseph. On a le droit de penser qu'elle en a mis du temps…
Saint Joseph, image du Père ? C'est le propos des deux premiers chapitres de la plume de Jean-François Froger. Il y faut un peu de patience car pour mettre en lumière ce pur modèle de parfaite humilité, autrement dit, de révéler autant que faire se peut la gloire propre du père de Jésus et de l'époux de Marie, il faut concilier la métaphysique, la théologie et la connaissance de la Révélation.
De la paternité divine à la paternité humaine, le chapitre inaugural, ne se contente pas de poser « les problèmes que soulèvent la révélation évangélique et la doctrine de l'Église à propos de la paternité de Joseph ». Il fournit aussi des clés pour comprendre le récit de la Création de l'Homme, « dans sa plénitude métaphysique exprimée dans les justes rituels des hommes et des sociétés ».
On est prévenu d'emblée : on ne va pas de la paternité humaine à la paternité de Dieu : « pour comprendre la paternité humaine, il faut prendre notre modèle de compréhension en Dieu et non pas dans notre expérience ». Il faut regarder ce que nous dit la Révélation qui vient corriger (si nous le voulons bien, mais que cela est difficile !) nos représentations humaines. Or, si l'expérience ne permet pas d'atteindre à une juste idée de la paternité divine, il faut bien partir de cette expérience, individuelle ou collective, et laisser la Révélation l'éclairer d'une lumière nouvelle et la rectifier… C'est la démarche que suit l'auteur en examinant plusieurs points essentiels, à commencer par la question de la relation familiale. Il n'y a de père que lorsqu'une femme met au monde un enfant et que cet enfant est celui d'un homme, de préférence son époux. Et il n'y a de père que s'il y a un homme, « un fils de ». Cela semble évident : ces fondements naturels sont pourtant aujourd'hui bien ébranlés pour ne pas dire rejetés.
La marque distinctive de l'humain, les fondements de la nature humaine, ce sont deux capacités : celle « d'instituer une relation de droit » et « la capacité à une parole créatrice prononcée par les époux ». Les bêtes ne se marient pas… « Un homme ne peut naître que comme le fruit d'un contrat de parole, ritualisée selon la Loi divine révélée depuis la Chute. » Le contrat de mariage n'est pas d'abord un modèle juridique, mais une institution humaine qui sort l'homme de l'animalité, ou qui figure son humanité. « Toutes les populations n'accèdent pas à cette qualité du contrat humain, la polygamie ou la polyandrie, le divorce et l'adultère ou l'absence de parole viennent contredire cette institution. » On mesure à ces lignes la violence inouïe et silencieuse qui frappe les populations encore sous le joug de ces principes d'iniquités.
La « chair unique » que l'époux et l'épouse sont destinés à former est une unicité qui révèle la nature humaine à travers le lien légal du masculin et du féminin (qui est en quelque sorte condition de cette unicité). Parce que Joseph et Marie vont mettre au monde l'Homme parfait, dans une humanité régénérée, il est juste de dire que saint Joseph est « le ministre de notre salut ». Quoique non charnelle, sa paternité n'est pas une suppléance. Il montre la paternité humaine véritable à travers toutes les étapes connues (en particulier dans les Évangiles de l'enfance) de cette vie consacrée. Résignant son « moi » humain, Joseph n'a pas revendiqué la paternité de Jésus mais il a tenu son rôle de « rabbi », assumant tous les rôles de la paternité humaine. Et parce que cette paternité est parfaite, nous pouvons recevoir par saint Joseph un enseignement sur la paternité humaine. Et par là, comprendre la paternité divine que Jésus montre en même temps que ce Père qui est « la Vie » et qui donne en son fils et par son Fils, la « vie incorruptible ».
L'analyse de ce chapitre inaugural se répercute dans le suivant qui aborde plusieurs points connus : la question de la généalogie de Jésus, de son sens ; la justesse de la conduite de Joseph lorsqu'il découvre l'adultère présumé de la femme qui lui est dévolue et la miséricorde extraordinaire que cette conduite révèle ; sa capacité à recevoir l'information divine et son obéissance aux ordres reçus en songe ; enfin ce que, en tant que père légal de l'enfant, il lui communique : sa lignée… Par Marie, mais aussi par saint Joseph, Jésus appartient charnellement à la lignée royale de David.
Ces deux chapitres d'une concision à saluer mériteraient cependant de plus longs développements que bien sûr les lecteurs audacieux pourront trouver dans Le Livre de la Création et dans Le Livre de la Nature humaine, du même auteur (dans la même édition).
Néanmoins, on se plaît à rêver et à espérer un petit ouvrage, qui serait aujourd'hui salutaire, spécialement consacré à ce mystère insondable qu'est la paternité humaine et à une plus juste appréciation de ce qu'est saint Joseph et par conséquent « qui » il est : l'essentielle médiation pour comprendre qui est et ce qu'est « Notre Père ».
Un tel ouvrage jetterait sans aucun doute une lumière implacable sur la vraie nature des chemins choisis par les sociétés occidentales en matière de morale sexuelle, dévoyant le contrat fondamental qui garantit l'unicité humaine, sa visibilité et sa foncière intelligibilité. Et par conséquent son inaltérable beauté.
Ouvrages associés :
Ebook : St Joseph, image du Père
Saint Joseph, image du Père
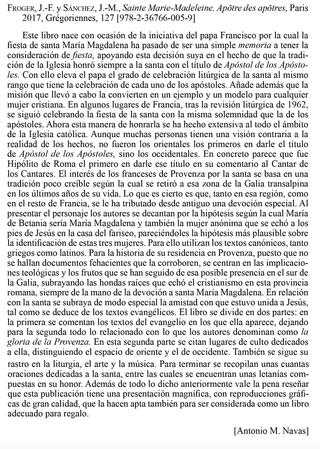
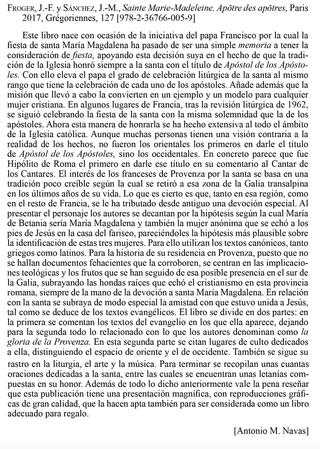
Archivo Teológico Granadino nº 80
Ce livre est né à l'occasion de l'initiative du pape François, qui a fait passer la fête de sainte Marie-Madeleine d’un simple souvenir au statut de Fête, en appuyant sa décision sur le fait que l'Église, traditionnellement, a toujours honoré la Sainte avec le titre d'Apôtre des apôtres. Ainsi, le Pape élève le degré de célébration liturgique de la Sainte au même rang que celui de chacun des apôtres. Il ajoute également que la mission qu'elle a réalisée en fait un exemple et un modèle pour toute femme chrétienne. Dans certaines régions de France, depuis la révision liturgique de 1962, la fête de la Sainte se célèbre avec la même solennité que celle des apôtres. Aujourd’hui, cette façon de l'honorer s’étend à toutes les églisescatholiques. Bien que beaucoup de gens aient une vision contraire à la réalité, ce ne sontpas les Orientaux qui lui ont donné le titre d'Apôtre des apôtres, mais les Occidentaux. En particulier, il semble qu'Hippolyte de Rome ait été le premier à lui donner ce titre dans son commentaire sur le Cantique des cantiques. L'intérêt des Français de Provence pour la Sainte se fonde sur une tradition incertaine selon laquelle elle se serait retirée dans cette région de la Gaule transalpine dans les dernières années de sa vie. Ce qui est certain, c'est que, dans cette région, comme dans le reste de la France, une dévotion particulière lui est portée depuis très longtemps. En présentant le personnage, les auteurs retiennent l'idée queMarie de Béthanie serait Marie-Madeleine mais aussi la femme anonyme qui est tombée aux pieds de Jésus dans la maison du pharisien, rejoignant l'hypothèse la plus plausible sur l'identification de ces trois femmes, en s’appuyant sur les textes canoniques, grecs et latins. Pour l'histoire de sa résidence en Provence, en l’absence de documents fiables pour l’étayer, ils se réfèrent aux implications théologiques et aux œuvres issues de cette présence possible dans le sud de la Gaule, en soulignant les racines profondes que le christianisme a fixées dans cette province romaine, toujours à la dévotion pour sainte Marie-Madeleine. En ce qui concerne la Sainte, la relation particulière qu’elle eut avec Jésus est soulignée d'une manière spéciale, comme on peut la déduire des textes évangéliques. Le livre est divisé en deux parties : dans la première, sont commentés les textes de l'Évangile dans lesquels Marie-Madeleine apparaît ; dans la seconde, est regroupé tout ce qui concerne ce que les auteurs appellent « la gloire de la Provence ». Dans cette deuxième partie sont cités des lieux de culte qui lui sont dédiés, en distinguant l'Orient de l’Occident. Les auteurs suivent aussi sa présence dans la liturgie, l'art et la musique. Enfin, sont réunies quelques prièresdédiées à la Sainte, parmi lesquelles des litanies composées en son honneur. De plus, il convient de noter que cette publication est d’une facture Ouvrage associé :


Cahiers de Science & Vie
Recommandé dans le hors-série "Les Merveilles du monde chrétien"
Ouvrage associé :
Site Narthex
Le mot relique renvoie à une certaine controverse. Longtemps assimilée au symbole d’une foi populaire presque superstitieuse, la relique fascine et interroge. Il n’existait à ce jour aucun ouvrage de fond sérieux sur la question. Ici, l’auteur s’attache en toute objectivité à nous faire une description détaillée des reliques sous un angle original.
En effet, après avoir rappelé l’histoire et la définition des reliques, l’auteur s’intéresse davantage aux reliques d’aujourd’hui. Ainsi, outre les reliques les plus insignes de la chrétienté (le tombeau du Christ à Jérusalem, le Linceul de Turin...), l’auteur pointe le doigt sur les reliques méconnues et prestigieuses de Provence. Sont étudiées dans cet ouvrage, le cas des grandes reliques conservées dans notre région méditerranéenne (Marie-Madeleine, Lazare, Marie-Jacobé…) contribuant ainsi à nous permettre une meilleure connaissance de ces restes sacrés.