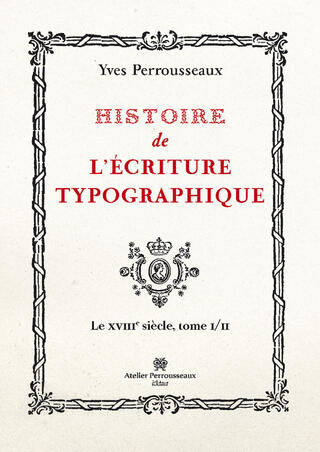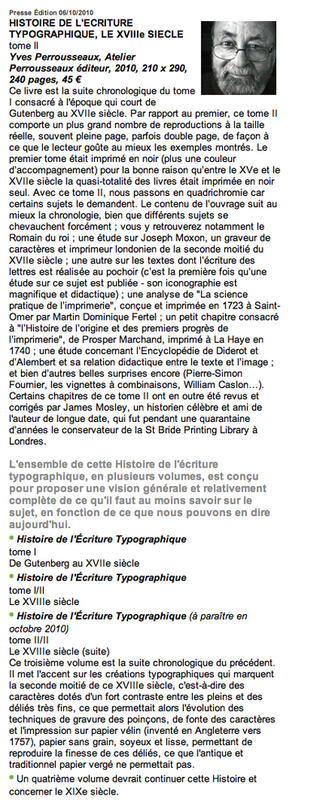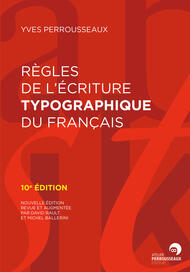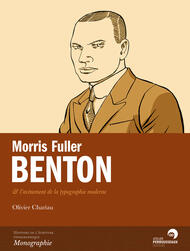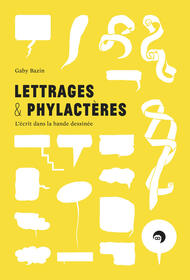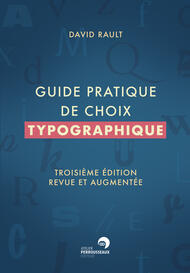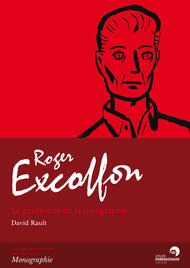Yves Perrousseaux s’est lancé dans un énorme et passionnant projet : raconter, en plusieurs tomes, l’histoire de l’écriture typo graphique. « Ces livres, je les fais tels que j’aimerais les lire. Quand on les lit c’est comme un ami qui vous parle. » Ces ouvrages de référence sont illustrés de très nombreux docu ments. La réalisation de cet ensemble généreux s’étalera sur plusieurs années.
Les origines de cet ouvrage
Quand on me demande les motivations qui m’ont amené à réaliser cette Histoire de l’écriture typographique, je ne sais jamais bien quoi répondre. Le sais-je moi-même ? Pas si sûr. En fait, dans mon inconscient, c’est sans doute la conséquence logique d’avoir acquis au fil du temps et d’une façon épanouissante un certain nombre de connaissances dans ce domaine si particulier et si mal connu en France, principalement durant les quinze ou vingt premières années de ma participation aux Rencontres internationales de Lure. À cela s’ajoute une autre passion : celle de transmettre, et de transmettre au plus grand nombre, comme Gérard Blanchard savait si bien le faire, à sa façon, et exhortait son monde à en faire autant. C’est véritablement un plaisir que transmettre des connaissances qui vous passionnent à des personnes qui en ont envie (et non pas contraintes) : non seulement les étudiants et les professionnels, mais également des gens d’ailleurs qui n’avaient jamais pris conscience que les lettres qu’ils utilisent sur leur écran d’ordinateur et qu’ils voient et lisent tous les jours ne tombent pas du ciel, mais ont une origine et une histoire, et que celle-ci est le résultat de la pensée des hommes, au fl du temps, dans une suite de circonstances bien précises, comme le répétait Ladislas Mandel. Mais je comprends également qu’il y ait des gens que ces centres d’intérêt n’attirent pas du tout. Depuis tout petit, j’ai toujours été passionné par l’existence de l’écriture, par le fait que la matière vivante a été suffisamment évoluée, à partir d’un certain moment de son développement, pour matérialiser ses émotions, sa pensée et son histoire. Ce qui lui permet de les fixer et de les transmettre aux générations à venir. Il se trouve que, par un enchaînement de circonstances, j’ai participé pour la première fois à la session d’été de ce que Maximilien Vox appelait à l’époque « L’École de Lure ». C’était en 1969 et j’avais alors 29 ans. Depuis une bonne année, j’habitais avec mon épouse à Forcalquier (à 15 km de Lurs), après avoir quitté Paris (où j’avais travaillé dans le service fabrication des Éditions de Montsouris et de Bayard-Presse), à la suite de mon arrivée chez Robert Morel comme chef de fabrication de sa maison d’édition installée en pleine montagne dans la région. C’est Henri de Montrond qui nous avait mis en relation. Il y a donc 41 ans de cela, et dans ce grand morceau de vie je n’ai manqué ces rendez-vous annuels de Lurs que deux fois. Et, comme vous pouvez vous en douter, j’en ai vu et entendu des choses, et le bagage accumulé représente un bel empile-ment de strates ! Les sujets débattus m’intéressaient d’autant que j’avais tout à apprendre et que les intervenants étaient souvent des personnages hauts en couleur. Dans les années 1970, la quasi-totalité des sujets abordés concernait la typographie, son évolution au fl du temps, ses contraintes et sa lisibilité. Lurs était à cette époque, et depuis 1952, le seul lieu au monde où l’on abordait et confrontait ces sujets à un tel niveau, et l’on y venait de partout pour cette raison précise. J’ai connu les dernières années de l’époque de Maximilien Vox, de Jean Garcia et des ténors de cette génération (en fait celle de mes parents), et maintenant ils sont quasiment tous morts. Je me rappelle d’une intervention de John Dreyfus (qui était le directeur artistique de la Monotype à Londres) concernant la visibilité et la lisibilité des lettres. Au moyen de deux projecteurs de diapos, il superposait sur l’écran mural (par exemple) un « a » minuscule de Plantin dans une certaine teinte et un « a » minuscule de Garamond dans une autre, et déplaçait les deux images l’une sur l’autre, ce qui fait que les parties communes à chaque alphabet (ce qu’Adrian Frutiger appelle « le noyau dur de la silhouette de la lettre ») étaient de suite mises en évidence car apparaissant dans une troisième teinte composée de la superposition des deux premières. La démonstration de John concernait donc les parties pertinentes de chaque alphabet qui, elles, avaient conservé leur teinte première. Tout ça dans un français impeccable et l’accent distingué de la City. Je vous laisse deviner la qualité de la discussion qui s’enchaîna avec des Fernand Baudin, Aldo Novarese, Albert Hollenstein, Luigi Cesare Maletto, Robert Risler et bien d’autres.
Les « Lursiens » qui m’ont le plus influencé
Ce sont quelques-uns de ces « piliers de Lure » qui m’ont fait découvrir la complexité et l’historique de la typographie. Les années passant, c’est maintenant à mon tour de renvoyer l’ascenseur en apportant ma contribution à ma façon, et cela d’autant que parmi les « Lursiens », je suis le seul, entre la génération qui me précède et la génération qui me suit, à être passionné par ces sujets historiques. C’est comme ça. Le premier fut Roger Excoffon. Les premières années, je dois dire que je n’avais guère de communication avec lui. Il avait un aspect froid et rigoureux qui m’intimidait, d’autant plus qu’il était l’une des grandes vedettes graphiques et typographiques françaises de cette époque, et que moi je n’étais qu’un débutant venant de la fabrication qui ne connaissait pas grand-chose aux préoccupations de ces grands messieurs. Je m’escrimais alors à faire bouillir la marmite (mes trois enfants étaient tout petits) en réalisant des travaux graphiques tout à fait banals pour une clientèle locale qui se demandait à quoi pouvait bien servir ma profession, puisque jusqu’à présent, et depuis des siècles, « on allait voir l’imprimeur ».Puis un beau jour, il me prit en sympathie et cela a été le point de départ d’une relation qui dura plusieurs années, jusqu’à sa mort en 1983. S’il passait une bonne partie de son activité professionnelle à Paris (c’était l’époque d’Excoffon Conseil), il aimait venir travailler dans sa maison de Lurs, chaque fois que faire se pouvait. C’est lors de ses séjours que nous avons eu, chez moi, parfois chez lui, des conversations lors desquelles il m’a appris énormément de choses et surtout m’a donné confiance en moi. Autant, à Paris, il était habillé en Parisien et roulait en Mercedes, autant en Haute-Provence, il venait chez moi dans sa vieille Dauphine qui fut jadis probablement d’un certain rouge, habillé d’un jean usagé et de chaussé de vieilles espadrilles. Roger, dans l’intimité, n’avait plus rien à voir avec l’Excoffon dans l’exercice de ses fonctions officielles. En fait il n’était ni hautain, ni distant, mais plein de bon sens et finalement plutôt timide. Il m’a longuement expliqué que lui aussi était un graphiste autodidacte et que lui aussi travaillait intuitivement. Il s’était donc formé tout seul, aidé en cela par une curiosité visuelle et intellectuelle, et par beaucoup de réflexion et de temps. Je me trompais lourdement, me disait-il, de croire que les participants aux Rencontres de Lure ne réalisaient que des chefs-d’œuvre graphiques à longueur d’année (ceux qu’ils présentaient à Lurs). En fait, ils étaient connus par quelques travaux exceptionnels (qui en général ne leur rapportaient pas un sou) et le reste du temps faisaient bouillir la marmite en réalisant des travaux tout à fait banals et trop souvent dénaturés par les exigences des clients. Par sa simplicité et son humanité, Excoffon m’a permis d’oser exprimer les talents dont j’ai hérité, et non pas d’imiter ceux supposés du voisin. Je dois également beaucoup à René Ponot. Ses interventions historiques me comblaient. Il avait une disposition certaine pour la précision et l’exactitude de l’information et m’expliquait que quand on réalise un travail historique, il était indispensable, dans toute la mesure du possible, de vérifier les informations recueillies en comparant différentes sources, et dans le doute ne pas hésiter à dire franchement que l’on n’a pas de réponse à telle question. C’est, sans aucun doute, lui qui m’a transmis le virus de l’histoire de la typographie. Sans lui, je n’y aurais probable-ment jamais été sensibilisé au point d’avoir un jour envie de m’y plonger à mon tour.Il était l’un de ceux qui ont le plus participé à la mise au point de la classification Vox à partir de 1954, et on m’a souvent rapporté que ce ne fut pas du plus simple et que les murs de la Chancellerie ont tremblé plus d’une fois. Des années après l’adoption, en 1962, de cette classification par le bureau de l’Atypi (composé alors de Charles Peignot, John Dreyfus, Hermann Zapf, Adrian Frutiger, Walter Tracy et Maximilien Vox), il devait bien être le seul à pouvoir l’expliquer aussi simplement que l’on raconte une histoire aux enfants. Il nous a quittés le 1er mars 2003. Quinze jours auparavant, je lui avais offert Le livre et l’historien, un ouvrage collectif sous le patronage de l’École pratique des Hautes Études, qui venait d’être publié chez Droz. Il n’a pas dû en profiter beaucoup.
Ladislas Mandel m’a également appris bien des choses sur l’histoire des écritures manuscrites et de la typographie. En 1998, j’ai publié son premier ouvrage Écritures, miroir des hommes et des sociétés, puis, en 2004, le second : Du pouvoir de l’écriture. Nous nous sommes pris de bec d’une part parce que « son caractère Messidor, qui n’a pas d’italique car c’est une Humane et qu’à la findu xve siècle les italiques n’étaient pas encore inventés » et qu’il voulait absolument faire figurer « du [soi-disant] Messidor italique en italisant son romain par anamorphose », et d’autre part nous nous sommes encore pris de bec parce que ses documents iconographiques (presque tous des photocopies d’ouvrages qu’il avait dans sa bibliothèque) étaient de mauvaise qualité et que, par-dessus le marché, il les voulait reproduits en grande dimension. Je lui reprochais encore la faiblesse de ses légendes. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a commencé à me prendre au sérieux. Il était temps, j’avais plus de 60 ans quand même et nous nous connaissions depuis une trentaine d’années, et c’est l’époque où je commençais le premier volume de mon Histoire. À partir de ce moment-là, j’ai découvert un bonhomme qui pouvait être fort sympathique, en tout cas un curieux personnage. Il m’invitait de temps à autre chez lui au Paradou, près d’Arles (à deux heures de route de chez moi), parfois pour deux jours. Le fait de pouvoir parler typographie était un plaisir que nous partagions tous les deux, c’est sûr. Il savait être drôle et spirituel. Il était alors veuf ; sa femme, d’origine russe, qui fut médecin et que j’ai connue, était morte quelques années auparavant. Il était gourmand et bon cuisinier. Plusieurs fois, il m’a fait participer à son rituel au grand marché d’Arles qui a lieu le samedi matin. Il y avait ses habitudes, ses produits et ses marchands, et à midi sonnant il retrouvait une bande de copains à la terrasse d’un café du boulevard des Lices. C’était sympa. En tout cas, je lui suis infiniment reconnaissant de m’avoir ouvert sa fameuse bibliothèque raisonnée dans laquelle se trouvaient des ouvrages représentatifs de toutes les époques. Cette source iconographique (comme celle de François Richaudeau d’ailleurs) m’a été d’une aide majeure pour la réalisation des trois premiers volumes de mon Histoire. Par contre, on le sait, Ladislas avait sur certains points historiques des idées affirmées qu’il devait bien être le seul à partager, et au sujet desquels j’évitais de le heurter de front. Ça n’aurait servi à rien. Il nous arrivait de disserter doctement sur la mort, un peu comme les philosophes grecs sur l’Acropole, et il me disait : « Tu sais, à mon âge, je peux mourir n’importe quand, en un clin d’œil ; un rien peut suffire. » Et de fait, il est mort en un clin d’œil, à 85 ans, un samedi matin d’octobre 2006, assis dans le divan bleu foncé de sa chère bibliothèque. Nous avions prévu que je lui rende visite la semaine suivante. Gérard Blanchard, également, m’a beaucoup apporté. Je ne m’étendrai pas trop à son sujet car la plupart d’entre vous l’ont bien connu et savent de qui et de quoi je parle. Ses interventions étaient magistrales. J’ai beaucoup appris lorsque, pendant la dernière année de sa vie, j’ai réalisé avec lui ce que l’on pourrait appeler la « mise au net de maquettes surraturées » qu’il modifiait sans cesse. Aide au choix de la typo-graphie est sorti début mai 1998, et Gérard est mort fin août de cette même année. Il me disait : « Dans ce livre, j’ai mis tout ce que je savais, je ne sais rien de plus. » Comme je suis d’un naturel plutôt calme et patient (j’en remercie mes parents), que je suis à l’aise dans les travaux de longue haleine, la cervelle concentrée et dans le silence absolu, sans relever la tête pendant des heures (certains disent que j’aurais dû être bénédictin), je n’ai jamais trouvé anormal qu’il modifât son ouvrage que j’ai dû refaire au moins trois fois, d’autant que quand je réalise mes propres livres, je perfectionne également mes pages je ne sais combien de fois, parfois pour ne changer qu’un mot qui convient mieux, ou une ponctuation plus appropriée. Et j’ai découvert que mon dieu s’énervait parfois, pas forcément contre moi d’ailleurs même s’il m’arrivait de ne pas deviner assez vite ce qu’il n’avait pas encore eu le temps de formuler. Il était étonné de mon calme et de ma patience, comme moi de son savoir et de son savoir-faire.
Ma façon peu orthodoxe de travailler
On me demande parfois comment je procède pour faire mes ouvrages de longue haleine comme ceux de cette Histoire de l’écriture typographique. Les gens me supposent organisé, avec des fches bien classées. Il n’en est rien. En général, un auteur écrit son texte au kilomètre ; lui ou une autre personne recherche l’iconographie, et un graphiste réalise la mise en pages, tant bien que mal en fonction des indications qu’il peut (ou non) recevoir. En ce qui me concerne, je réalise tout cela à la fois et peux donc faire tout ce que je veux (sauf de raconter des sottises, et pourtant il en reste quelques-unes) et en prenant le temps qu’il faut, ce qui m’apporte le recul indispensable à la maturation des sujets, d’autant qu’ils sont quand même complexes. De 1995 jusqu’en 2003 j’étais, en plus et avec l’aide de mon épouse, l’éditeur et pour une part le diffuseur, et j’assumais les relations publiques. Cela en plus de mon métier de graphiste qui consistait principale-ment alors à mettre des livres en pages pour des clients éditeurs comme Équinoxe, ou des catalogues industriels techniques, ce qui était moins drôle mais rapportait de quoi vivre correctement.Pour les textes, j’étudie un certain nombre de livres d’historiens, que je cite, et je les compare. Je me suis inspiré de la méthode de Robert 1er Estienne qui procédait de cette façon en compilant des manuscrits de différentes époques et origines. C’est long, mais on distingue ainsi plus facilement ce qui doit être le vrai du rajout. Je me méfie énormément des études publiées sur Internet, car avec l’expérience que j’ai acquise, je me rends compte qu’elles sont assez souvent truffées d’inexactitudes (merci René Ponot de m’avoir sensibilisé à tout ça). Dans mes recherches, il m’arrive de retrouver les sources dont se sont servis, de leur temps, les personnages dont je parle ici. La boucle se ferme, c’est logique. Pour les illustrations, je me sers principalement de ma propre bibliothèque, de celle de bons amis, mais égale-ment de bibliothèques qui me veulent du bien, comme la BnF, de l’Arsenal, de l’École Estienne (et merci à Anouk Seng qui est si attentionnée et à Jean-Yves Quellet qui me fait les photos), celle de Blois, de Rennes, de Tours, de Lyon, du Musée de l’imprimerie de Lyon, du monastère bénédictin de Ganagobie, etc. Au début j’ai eu avec certaines bibliothèques des difficultés au sujet des droits de reproduction qui font que le livre revient trop cher et n’est plus vendable, alors que mon intention est que le plus grand nombre puisse acquérir ces connaissances. Puis les personnes concernées ont bien fini par prendre conscience que ces ouvrages culturels n’avaient pas pour but premier de faire la fortune de l’auteur, ni celle de l’éditeur d’ailleurs. Ce qui fait que dans la majorité des cas, il n’y a pas de droits de reproduction, parfois juste quelques frais de prises de vue. Je suis donc devant le gabarit de ma double page blanche sur l’écran et je mène de front :1. la rédaction du texte principal, que j’invente à ce moment-là et que je peaufine cent fois,2. la rédaction et le positionnement (souvent provisoire) des notes latérales,3. le choix final des illustrations, le scan d’un bon nombre d’entre elles, les retouches sur Photoshop et leur place-ment,4. ainsi que la rédaction de leur légende. Tout fonctionne ensemble. La compréhension de mes démonstrations dépend de l’agencement de ces quatre types d’éléments. Bien souvent les légendes des illustrations apportent des informations utiles que le lecteur ne retrouvera pas dans le texte principal. De cette façon s’il ne le lit pas, il regardera certainement les illustrations et lira leurs légendes, c’est-à-dire ce que je veux qu’il apprenne au moins. Je travaille lentement et pour ce genre de travail, qui demande du cousu main, c’est très bien ainsi. Je travaille chapitre par chapitre en fonction des éléments que je possède et quand je sens qu’il est mûr, et mon travail n’est pas forcément chronologique tel qu’il apparaît en final dans le livre imprimé. Mais comme celui-ci va durer plusieurs années, il m’arrive de découvrir, en étudiant un tout autre sujet, des informations ou des illustrations que je ne connaissais pas (ou auxquelles je ne pensais plus) et que j’estime utile d’être rajoutées à un chapitre déjà achevé, et qui peut se situer 200 pages en amont. Ce qui m’oblige parfois à bousculer la mise en pages, la taille de mes textes et des illustrations déjà en place, à renuméroter les illustrations, et (c’est le pire) à remettre d’aplomb la numérotation de renvois de figures se trouvant dans les textes (d’où certains oublis).
Abordons également ma rétribution d’auteur, puisqu’on me pose parfois la question. En fait, c’est le même problème que celui des droits de reproduction des illustrations : un tel travail ne peut pas être rétribué à un prix convenable. Par exemple, j’ai mis presque quatre années à réaliser le premier volume (de Gutenberg au XVIIe siècle) et environ trois années pour les deux volumes sur le XVIIIe siècle qui viennent de paraître : même en supposant une rétribution au temps passé, équivalente à un salaire mensuel au niveau du SMIC, vous vous rendez bien compte que le prix de vente du livre serait bien trop cher. Conclusion, pour réaliser de tels ouvrages, il faut le faire par passion et vivre d’autre chose. Les contenus en ce qui concerne ma façon de concevoir les contenus, je tiens compte du fait qu’il existe peu d’études globales sur l’histoire de la typographie d’avant le XXe siècle, et ça tombe bien parce que ces siècles passés sont ceux qui me passionnent le plus. Il existe bien entendu les travaux de Francis Thibaudeau au début des années 1920 (et qui ne concernent que la France) et de l’Américain Daniel Berkeley Updicke (dans le courant des années 1930), mais leur approche est traditionnelle, alors que la mienne ressemble plutôt à la façon de raconter des histoires aux enfants sages, et parfois on a peur du loup. Les travaux d’autres historiens de haut niveau concernent davantage des sujets ciblés. Ma façon de faire comprendre les caractères consiste, pour une bonne part, à brosser leur contexte et non pas seulement à les montrer et à les analyser. Voici quelques exemples pour expliquer la façon dont j’aime procéder. J’ai, bien entendu, commencé par Johannes Gutenberg. C’était en 2001. Mais j’ai vite pris conscience qu’il me fallait auparavant aborder le contexte qui avait condition-né sa démarche, car Gutenberg n’a pas réalisé son œuvre ex nihilo (les autres personnages, qui ont suivi au long des siècles, non plus d’ailleurs). C’est pour cette raison que j’ai réalisé le chapitre qui précède (la fabrication du papier à la forme qui existait depuis un siècle au moins, ainsi que l’impression [en tant qu’acte d’imprimer, par exemple sur des étoffes ou en xylographie], la vis sans fn qui existait déjà chez les Romains en viniculture, et ce que l’on peut supposer de l’impression métallographique).Plus on remonte dans le temps et moins il existe de matériel de travail fiable. C’est ainsi que bien des inexactitudes nourrissent le grand public. Par exemple, il vaudrait mieux qu’il sache que Gutenberg n’a jamais « inventé l’imprimerie », peut-être même pas la typographie en tant qu’art de reproduire l’écriture industriellement au moyen de caractères fondus en alliage métallique, mobiles et réutilisables. Son trait de génie serait l’invention du moule manuel à fondre les caractères (qui effectivement a tout changé), permettant de fondre de grandes quantités de types identiques. Et encore on se demande aujourd’hui si l’on ne doit pas son invention (ou du moins sa finalis-tion) au jeune Peter Schöffer, le jeune homme astucieux et bricoleur de l’équipe. Si l’on donne le titre d’inventeur à Gutenberg, c’est uniquement parce que sa Bible à 42 lignes est incontestablement le premier important ouvrage imprimé. Et cela clôt les disputes.Autre exemple. Depuis des siècles on date l’invention de Gutenberg de l’année 1440. Sur quelle base vérifiable ? Aucune. Je ne vais pas ici refaire mon chapitre, mais le lecteur aime bien apprendre que la découverte d’une lettre (en 1982, ça ne fait que 28 ans), du cardinal Enea Silvio Piccolomini (le futur Pie II) informe que, de passage à Francfort en octobre 1454, il a lui-même vu avec étonne-ment des cahiers d’une Bible mise en vente publique. Il y en avait 158 exemplaires, tous semblables, d’une qualité « d’écriture » très nette et sans faute et qu’on pouvait lire sans lunettes. Du jamais vu. Il regrette après coup de ne pas en avoir acheté un jeu de cahiers complet. Le reste de la lettre ne fait aucun doute sur l’identification de la B 42.
Et ça, ni Thibaudeau, ni Marius Audin n’ont pu le savoir de leur vivant. Si cette Bible a été mise en vente en 1454, et en tenant compte de paramètres de mise au point de la technique, les premiers balbutiements de l’impression typographique ont plutôt dû démarrer entre 1445 et 1450, ce qui change beaucoup de choses pour la compréhension de la suite. Autre exemple encore. C’est pendant la Renaissance, en France du moins, et plus particulièrement dans les années 1530, que la typographie romaine prend le pas sur la typographie gothique. Mais comment les choses se sont-elles passées, et surtout pour quelles raisons ? Pas du tout par hasard. Et c’est ça qu’il est important d’expliquer. Raconter que les humanistes italiens, au siècle précédent, le Quattrocento, écrivaient leurs études concernant les auteurs de l’antiquité grecque et romaine (mis sous le boisseau par l’Église de Rome et on comprend pourquoi) non pas en cursive gothique qui était alors en usage un peu partout, mais dans une petite écriture, inspirée de la Caroline, pour manifester leur différence philosophique. Expliquer que ces humanistes ont refusé les caractères typographiques gothiques des premiers typographes allemands arrivés en Italie après le sac de Mayence en 1462, et qu’ils ont exigé la création de caractères imitant leur écriture, ce qui a donné le Jenson (1470 à Venise), puis les caractères gravés par Francisco Griffo pour Aldo Manuce, à partir de 1495. Expliquer que, toujours pour cette même raison de marquer sa différence, cette typographie humanistique (ou romaine) a d’abord été utilisée en France par Henri 1er Estienne à partir de 1513, puis par les humanistes français et finalement par la Réforme, pour différencier leurs publications des caractères gothiques que l’usage réservait aux livres de théologie et de liturgie de l’Église catholique. On com-prend alors tout autrement les douleurs d’enfantement des créations typographiques de cette époque et les raisons des persécutions, jusqu’au bûcher parfois, qu’ont vécu ces Robert 1er Estienne, Antoine Augereau, Étienne Dolet, Jean Jannon…Et la mise en place de la langue française, et l’invention de la ponctuation et celle de l’accentuation : elles ne tombent pas du ciel, comme dans la fable de La Fontaine Les grenouilles qui demandent un roi. Nous les utilisons tous les jours pourtant, comme monsieur Jourdain la prose.
Pour terminer je dirais encore que les contenus de cette Histoire de l’écriture typographique font partie de notre héritage culturel et, en ce sens, n’appartiennent à personne, hormis la façon de les exprimer. Je vais d’ailleurs commencer le XIX e siècle. C’est pourquoi, je considère ma participation à cet héritage que comme celle d’un rassembleur et d’un transmetteur de connaissances, pour la précision desquelles je n’hésite pas à demander le conseil et l’aide d’amis spécialistes de tel ou tel sujet, comme Jacques André, Pierre Duplan, Paul-Marie Grinevald, Rémi Jimenes, Michel Melot, James Mosley et d’autres, que je remercie sincèrement.